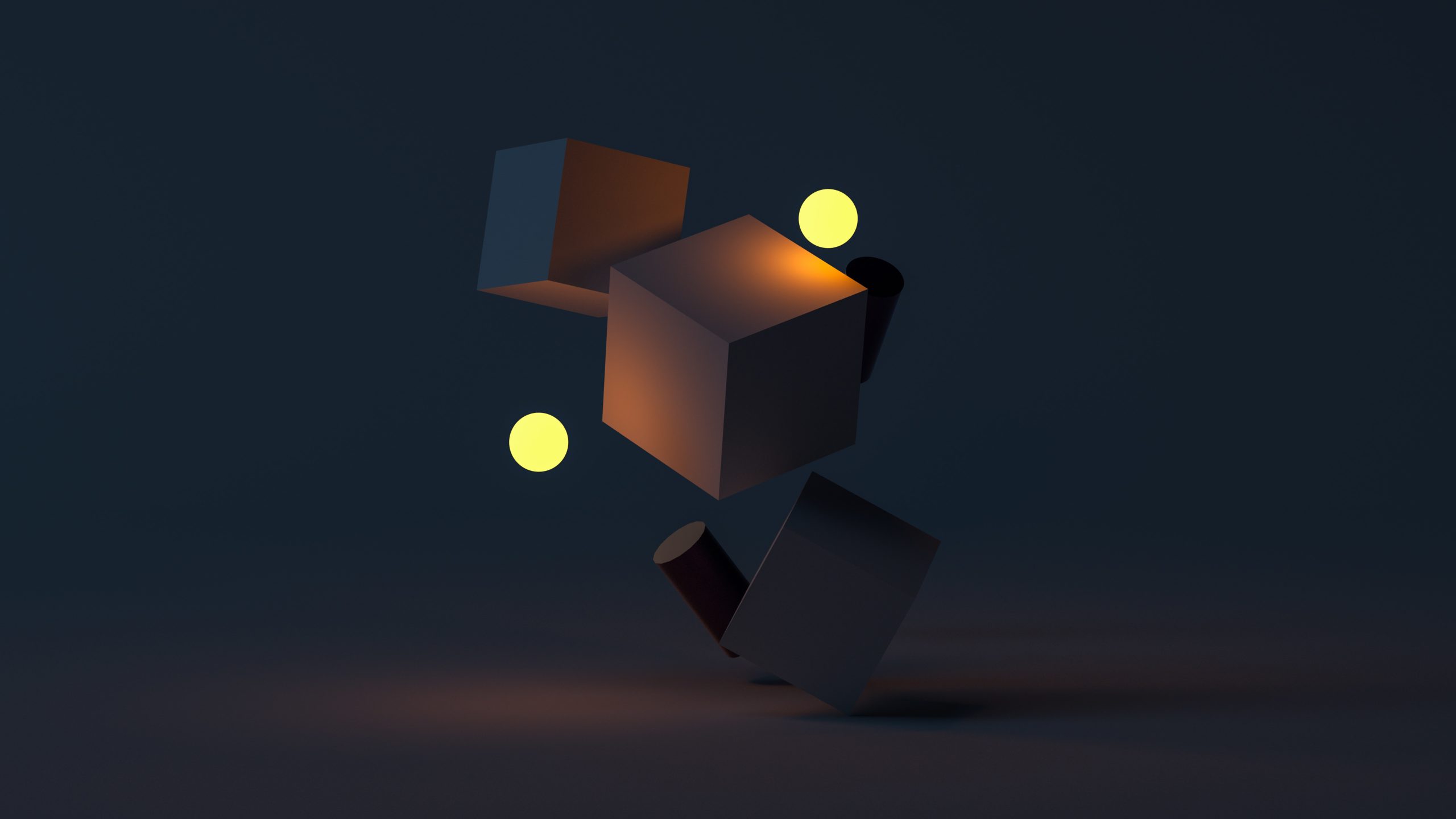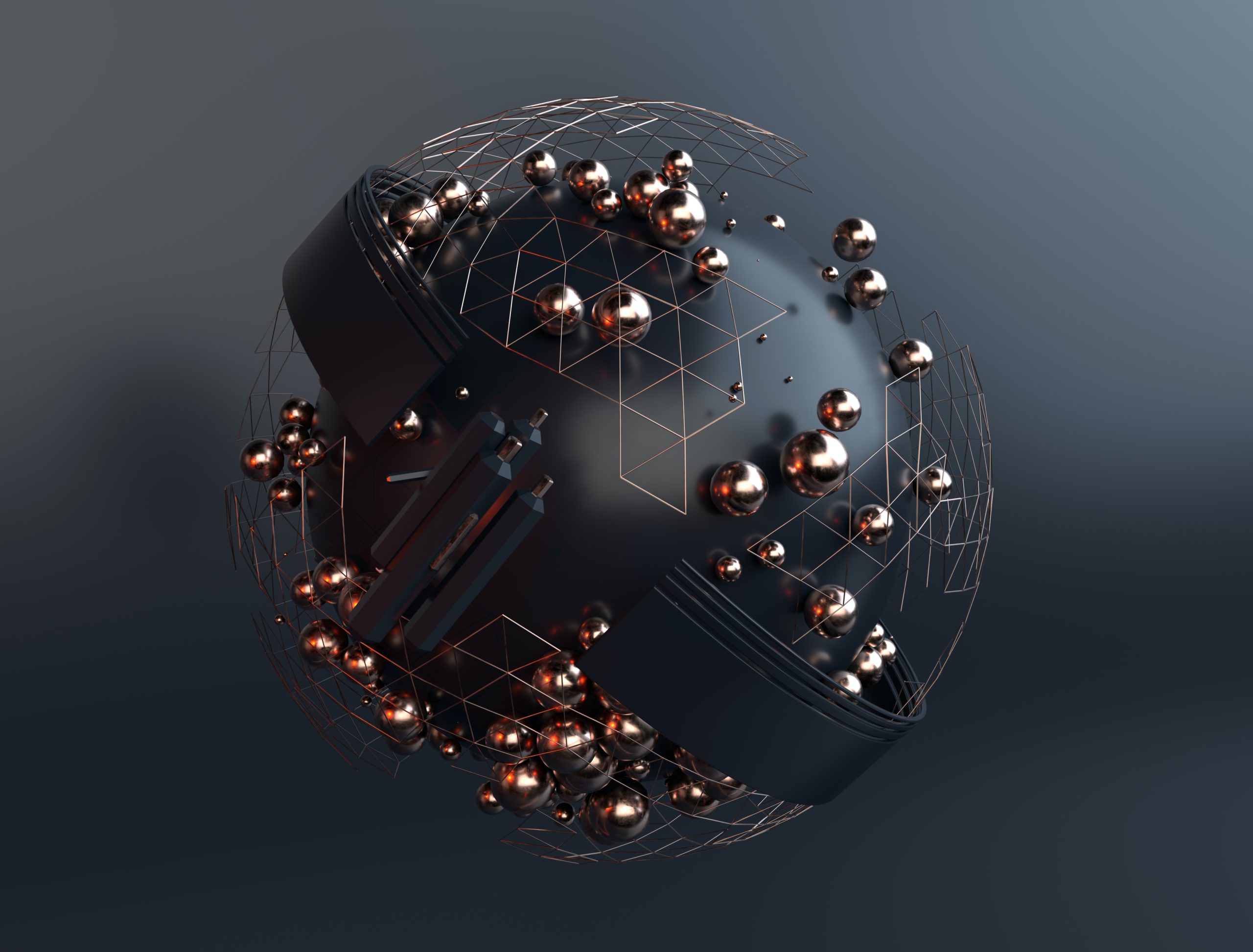Par Manuela Cadelli Juge Autrice de La légitimité des élus et l’honneur des juges (Samsa 2022)
« Gloire aux pays où l’on parle !
Honte aux pays où l’on se tait. »[1]
« Nous n’avons donc jamais incliné le valable devant le réel. »[2]
Deux questions m’intéressent dans la réflexion qui est menée sur le devenir du Barreau : quel est le rôle de l’avocat face au juge et à l’institution judiciaire lorsqu’ils sont dysfonctionnels ? Et quelle est sa place dans les démocraties affaiblies et l’État de droit menacé ?
L’avocat face au juge : ambiguïtés et vertus
La justice rendue dans les palais et son influence sur l’équilibre des institutions ne saurait être considérée comme le fait de la seule créativité des juges. Il n’y a d’intelligence que collective et le plus souvent, ce sont des avocats inventifs et déterminés qui suggèrent à la magistrature d’orienter le droit dans telle direction plus démocratique, émancipatrice ou même plus pragmatique. Les avocats sont ainsi des « partenaires de justice », véritables co-auteurs du Droit.
Au-delà de cette évidence, la question de la nature ou du statut des relations entre magistrats et avocats est encore discutée. Nous l’avons étudiée avec Jacques Englebert à l’occasion d’un arrêt prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 avril 2015 dans une affaire qui opposait l’avocat parisien Olivier Morice à la France et qui nous intéressait tous les deux[3]. L’avocat Olivier Morice avait été condamné par les autorités judiciaires françaises pour « diffamation publique envers des fonctionnaires publics ». Il avait en effet mis en cause dans une interview accordée au journal Le Monde, en 2000, les pratiques des deux magistrats instructeurs en charge de l’enquête ouverte à la suite du décès du juge Borel dont il défendait les intérêts de la veuve, en soulignant leur partialité et leur déloyauté à l’égard de la partie civile. Les magistrats instructeurs soutenaient en effet, une thèse – celle du suicide – pour des raisons tenant manifestement à la raison d’État et contre certains éléments du dossier qui autorisaient à soupçonner un assassinat. Seul un des deux juges, Madame Moracchini, avait cependant déposé plainte et réclamé des dommages et intérêts.
Dans cet arrêt prononcé en Grande chambre, la Cour européenne des droits de l’homme reconnait à l’unanimité que la France a violé la liberté d’expression de Me Morice garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette affaire est remarquable en ce qu’elle concerne un avocat revendiquant les garanties de la liberté d’expression dans ses relations avec l’institution judiciaire alors qu’il révélait une justice dysfonctionnelle en dénonçant le comportement frauduleux ou abusif de certains magistrats.
La Cour a développé sur ce point un raisonnement classique en appliquant les principes habituels de la liberté d’expression qu’elle a précédemment et généralement définis à savoir les critères du débat d’intérêt général et du jugement de valeur qui peut se prévaloir d’une base factuelle suffisante. Hélas, elle a aussi – et à l’évidence avec application – évité de répondre à l’invitation qui lui était expressément faite par le Conseil des Barreaux européens (CCBE), l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, le Conseil National des Barreaux et la Conférence des Bâtonniers qui étaient intervenus volontairement à la procédure, d’examiner la question du statut de l’avocat, en particulier lorsqu’il est confronté à la survenance de certains obstacles au loyal déroulement de la procédure. Nous avons donc voulu pousser plus loin l’analyse et proposer une définition du rôle et de la place de l’avocat qui corresponde aux attentes des citoyens qui les consultent pour être défendus face à l’institution judiciaire et face à l’État.
Dans l’analyse des rapports de la magistrature avec le Barreau a fortiori dans l’hypothèse où un dysfonctionnement est avéré, il convient de rappeler le contexte ambigu dans lequel les relations s’inscrivent. S’observe en effet un rapport de force qui est peu souvent décrit et qui conduit d’ailleurs certains à considérer que le rôle de l’avocat serait limité par la représentation qu’il assure d’une seule partie au procès, et serait alors à qualifier suivant l’expression de l’Ancien régime, de simple « auxiliaire » de justice[4]. A première vue, ce rapport de force est lié à l’obligation qu’a l’avocat de convaincre et donc en quelque sorte de séduire le juge. Même si dans le même temps, la subordination, la connivence ou la déférence excessive sont considérées comme déplacées. Car l’objectif est aussi de déjouer les évidences du dossier et donc les éventuels pré-jugements. En cela, l’avocat doit contrarier la justice, surtout en matière pénale. C’est un travail de pénétration mentale qui mobilise un nombre infini d’éléments de tous ordres : du choix des mots jusqu’à l’éducation reçue.
L’on serait hypocrite de nier le fait que l’avocat peut se trouver confronté à des juges dont soit l’éthique, soit le professionnalisme, laisse à désirer alors qu’il est pourtant appelé à les rencontrer de façon régulière dans le traitement de ses dossiers. Or, pour approcher au plus près le rapport de force qui caractérise cette relation, il suffit de rappeler que le justiciable n’ayant pas la possibilité de choisir son juge ne peut éviter celui que la loi lui attribue. La Cour européenne le souligne dans son arrêt Kyprianou c. Chypre, du 15 décembre 2005 :
« A l’évidence, tout avocat, lorsqu’il défend un client en justice, […], peut se retrouver dans la situation délicate de devoir décider s’il doit ou non s’opposer à l’attitude du tribunal ou s’en plaindre, tout en gardant à l’esprit les intérêts de son client. » (§ 175)
Que l’on songe, pour illustrer cette culture partagée, au renoncement fréquent des plaideurs à demander à l’audience que soient actés certains préjugés parfois malencontreusement émis par le siège, voire certains dysfonctionnements dans la conduite du procès, de même qu’au refus parfois opposé par le siège à ce que le greffier acte de tels incidents lorsque l’avocat, étranger à cet habitus, le réclame.
L’on doit également apercevoir que lorsqu’ils sont mis en cause et critiqués, les juges ont la possibilité d’attaquer par la voie procédurale les avocats qui ont à leurs yeux « l’insolence » de dénoncer certains dysfonctionnements, et ce devant d’autres juges, soit leurs collègues. Il ne faut pas être éminent docteur en sociologie pour comprendre qu’une sympathie systémique risque de marquer le traitement de ces procès[5]. Sans aller jusqu’à ces extrémités procédurales qui restent exceptionnelles[6], c’est la perspective d’être discrédité auprès des magistrats, cumulée à la crainte de voir leurs clients sanctionnés à l’occasion d’autres litiges, qui incitent trop souvent l’avocat à se taire et donc à couvrir malgré lui certains dysfonctionnements dont il est le témoin[7]. Nous avons relevé à cet égard avec Jacques Englebert que :
« La seule appréciation de procédurier, visant à disqualifier l’avocat qui, remplissant sa mission, soulève tous les moyens utiles à la défense, dans l’intérêt bien compris de ses clients, participe déjà à cette culture d’incompréhension quant au rôle réel de l’avocat, qui s’observe malheureusement ci et là au sein de la magistrature. Cette culture rencontre en écho, au sein du barreau, celle de la peur de déplaire à « son » juge, qui hante tant d’avocats et les incite à renoncer à certains moyens ou certains arguments qui risqueraient d’être considérés comme encombrants ou chronophages par le siège. »
Les magistrats reprochent parfois à certains avocats de tenter de déstabiliser un tribunal ou un juge ; le reproche est connu[8] . Il faut toutefois rappeler qu’en définitive, le dernier mot tant dans le traitement des dossiers de leurs clients que dans celui de leur propre mise en cause, appartient précisément à un juge. Ce n’est pas rien. Comment déstabiliser en outre ce qui tient fermement sur ses bases ? Un magistrat qui accomplit correctement son travail, avec un sens visible de l’écoute, une sérénité de bon aloi, et une saine curiosité à l’égard des éléments du dossier et des nuances du droit qui sont convoquées, sans craindre la charge de travail qui s’en déduit et en exprimant toute la neutralité et l’impartialité attendue par les justiciables et leurs avocats, ne peut à aucun moment être déstabilisé, en tous cas pas par un membre d’un barreau. L’on me dira qu’il s’agit là d’un tableau idéal et que la conjoncture n’est plus très porteuse de telle séquence. Il reste que l’avocat n’est en rien un ennemi en soi. Et les méfiances ou disqualifications qui se devinent – voire s’expriment – ici et là sont stériles et passent à côté du sens de l’office du juge. Je n’ai jamais compris pourquoi il faudrait « damer le pion » ou « couper l’herbe sous le pied » à un avocat, sauf à considérer qu’il est un obstacle à la solution qui a déjà été décidée dans son dossier.
A la condition que le respect des différentes fonctions marque les échanges, il n’est alors pas dramatique qu’un juge soit contrarié, même à l’audience. Aucun crime de lèse-majesté à déplorer car en somme chacun apprend tous les jours, de ses erreurs et de la contradiction qui lui est portée. Il y va ici évidemment de la formation, voire de l’éducation des magistrats.
Nous soutenions la même thèse pour la presse car en cette affaire Morice, la juge Moracchini ne mâchait ses mots en pointant, sans craindre la surenchère, « l’alliance du politique, des avocats et des médias pour déstabiliser sinon tuer le juge d’instruction » en stigmatisant ceux qui, comme « Me Morice et ses clients, envahissent les médias pour critiquer violemment les magistrats qui n’ont pas suivi leur lettre de mission », provoquant ainsi un « tintamarre médiatique » qui dicterait désormais la conduite de la justice « dépossédée de sa mission essentielle »[9]. On palpe bien la persistance de reflexes classieux d’un autre âge qui rejettent a priori toute critique et observation. Tous les acteurs judiciaires officient pourtant face à la presse dont le rôle est d’assurer aux audiences la publicité voulue par le Constituant, c’est-à-dire une forme de contrôle démocratique de leurs manières de travailler. Il faut s’en réjouir car l’entre soi et le secret ne servent pas le travail de la justice. C’est affaire de procédure : le secret n’empêche pas les abus donc il les permet. Il est vertueux au contraire de montrer au public les ressorts vertueux du procès, l’importance de la parole également distribuée à tous et le fait par exemple que le simplisme et la caricature sont incompatibles avec l’entreprise considérée. Il faut « donner à voir » que nous tentons d’être à la hauteur de nos fondamentaux et des attentes du citoyen dans chaque dossier. Et si la justice est actuellement « dépossédée » de ses missions essentielles, ce n’est pas le fait des médias ou de la critique que peut en faire un avocat. Le raisonnement serait donc a priori identique pour l’avocat et le journaliste : ils sont susceptibles de lancer l’alerte sur les fraudes et lacunes qu’ils observent et ce rôle est essentiel. C’est d’ailleurs ce que plaidaient devant la Cour les barreaux qui étaient intervenus pour soutenir la thèse de Me Morice : la parole de l’avocat qui dénonce un dysfonctionnement doit être garantie au même titre que celle du journaliste. La Cour l’a d’ailleurs rappelé : un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, l’autorité judiciaire pouvant tirer un bénéfice d’une « critique constructive »[10].
Il est essentiel de pousser plus loin encore la protection dont doit bénéficier l’avocat dans ses rapports avec les magistrats car ce dont on parle lorsqu’on évoque son expression libre, c’est en réalité de son indépendance. Ces notions sont intrinsèquement liées sans qu’il soit nécessaire de préciser laquelle est à l’origine de l’autre. Or il arrive que la justice soit dévoyée par ses acteurs et devienne alors l’adversaire, voire l’ennemie, du citoyen. Il arrive encore que l’institution judiciaire se révèle un instrument de domination au service de la raison d’État. L’avocat est alors le mieux à même de déceler ce moment où le procès s’égare car il en a toute l’expertise. En cette hypothèse, face au devoir de révéler les dérives qu’il observe, il endosse à son tour un rôle institutionnel. Il n’en n’a pas le choix ; il le doit à la démocratie et à tous les justiciables, au-delà de celui qu’il défend[11]. Son indépendance doit être absolue car elle s’exerce alors au service de la justice, bien au-delà de la seule importance d’un dossier particulier. André Delvoye souligne à cet égard :
« L’indépendance et la liberté du juge ont nécessairement comme corollaire absolu l’indépendance et la liberté de l’avocat car l’avocat est l’égal du juge dans l’œuvre de Justice »[12].
Et pour Pierre Lambert :
« il n’est pas de justice véritable sans avocat, le droit de défense entendu dans son sens le plus large étant l’expression première du droit à la liberté ».
A propos de l’indépendance de l’avocat, Pierre Lambert s’interroge sur la possibilité d’accomplir sa mission si, indépendant vis-à-vis de son client, l’avocat ne l’était pas à l’égard des tiers et s’il avait à subir des influences, à redouter les puissances et à écouter les préventions[13] :
« La vérité est que l’indépendance de l’avocat est d’intérêt social, elle n’existe qu’en vue d’une bonne organisation de la justice. […]. Loisel fait dire à Pasquier qu’elle n’est point un privilège concédé à l’orgueil mais un droit revendiqué pour tous comme la plus sérieuse des garanties de Justice. […]. Loin de placer le Barreau au-dessus des lois, son indépendance a pour but de lui permettre d’en réclamer l’application. »[14]
Indépendant, donc et par principe imperméable aux pressions, l’avocat a véritablement – et presque politiquement – la charge en effet de mettre en cause le système. L’on voit la parenté avec l’indépendance du juge : toutes deux en définitive au service de la justice. Dans cette mission cruciale, l’avocat qui interpelle le système doit prendre la parole et l’exercer comme « un agir ». Et ce, au-delà de la procédure et pourquoi pas dans les médias ? C’est la vertu du débat public, et de la disputatio qu’elle implique. On a compris à quel point son intervention dépasse la simple défense des intérêts de son client et prend une dimension institutionnelle[15] mais on doit mesurer aussi le degré de courage qu’il lui faut et l’amère solitude à laquelle sa révélation le conduit lorsqu’il se trouve confronté à l’institution mais aussi – il faut l’admettre – à une sorte de corporation. Sa parole doit alors être protégée absolument[16]car elle sert à la fois l’institution judiciaire et le citoyen. Et le scénario qui permettrait de la brider ne contient in se aucune limite et recèle la possibilité d’entraver toute défense : si une menace pèse sur la place de l’avocat dans la démocratie, rien n’empêche de remettre en cause sa place particulière dans le procès. C’est spectaculaire en Turquie et en Égypte où des avocats sont poursuivis, condamnés et enfermés du seul fait d’avoir porté la défense de citoyens qui déplaisent.
Militer au service de la démocratie et de l’État de droit
Je veux encore élargir le propos au regard de l’hostilité particulière des temps que nous traversons. Ce contexte inédit marqué par le délitement démocratique, la disqualification, voire la haine du Droit et des droits de l’homme, le démantèlement des services publics et des solidarités, sans parler de la financiarisation et de la numérisation du monde, commande l’engagement de chaque acteur institutionnel et assermenté. Le Barreau connait une crise économique dont on parle peu dans l’espace public, outre qu’il est sommé de se « désincarner » par les injonctions de cette « Intelligence artificielle » que l’on nous « vend », au propre et au figuré, comme inéluctable et qui serait liée au Progrès ou au fameux « sens de l’histoire ».
Voici donc le réel : nous livrons à la société civile un service public asséché par la baisse de l’offre de justice en qualité et quantité ; certaines décisions de justice ne sont pas respectées par le monde politique ; la justice se voit également instrumentalisée pour répondre – pénalement – à des questions sociales, culturelles ou même sanitaires, comme on l’a vu durant la crise de la Covid 19. Outre qu’à court ou moyen terme elle court le risque de sa déshumanisation.
Or si l’avocat est un co-auteur de justice, il est aussi, tout comme le magistrat, un acteur clé de la démocratie et de l’État de droit car ils en maîtrisent tous les deux les fondamentaux et sont à même de déceler au plus tôt les basculements et les renoncements que peuvent imposer certaines politiques ou certains hommes prétendument providentiels. Ils ont ainsi l’expertise qui, conjuguée à leur sens de l’honneur, doit permettre de contrarier la tendance à l’œuvre. Qui plus est l’avocat n’est tenu à aucun devoir de réserve ; aucune chicanerie ne peut lui être opposée de ce fait comme au magistrat, abusivement le plus souvent. Tenus par un devoir de fidélité à la refondation démocratique qui a suivi la Libération, les acteurs de justice occidentaux qui bénéficient encore d’une certaine indépendance, avocats et magistrats, doivent dès lors entrer en militance – idéalement, dans un élan de refondation pensé et lancé avec tous les secteurs touchés par la déshumanisation et en concertation avec toutes les autres forces démocrates concernées – et cela simultanément sur deux fronts : dans le débat public et dans les palais et le traitement des dossiers qui leur sont soumis ou dans leur relation avec les justiciables.
J’assume le terme de militance que je définis comme un existentialisme dès l’instant où il consiste à s’engager et agir pour montrer, rappeler, faire exister, ou restaurer les fondamentaux déduits de la refondation voulue après la Libération dont nous nous revendiquons et qui relèvent dans notre relation au justiciable de cette « justice ineffaçable au cœur de l’homme » qu’évoque la philosophe Simone Weil dans L’enracinement[17]. Je plaide en somme que tous les idéaux démocratiques peuvent et doivent être servis par la militance des gens de justice contre la fascisation des temps[18].
Les seuls défis qui pèsent sur cette résistance sont la pertinence du verbe et la fermeté du courage. Tant il est vrai que l’on ne peut admettre que nous serions impuissants à affronter les maux de l’époque ; qu’ils relèveraient d’un fait, d’une hypothèse non négociable suivant le fameux principe Tina[19]. Que nous devrions faire preuve de « réalisme » et nous incliner face à ce qui vient. Quant aux arguments, ils sont connus et relèvent précisément des fondamentaux de justice qui nous sont communs.
Dans une tribune intitulée La liberté d’expression de l’avocat, qu’ils ont signée le 11 mai 2017[20], les bâtonniers et présidents d’Avocats.be, Jean-Pierre Buyle et Patrick Henry indiquaient en guise de conclusion :
« Le temps n’est plus où la défense se cantonnait strictement dans les prétoires ; elle doit s’exercer, aujourd’hui, partout où les droits individuels sont en cause ».
Précisément, les droits des citoyens sont actuellement partout en cause et au-delà, ce sont les fondements d’une sociale démocratie non dévoyée dont nous sentons l’effondrement. En cette séquence extraordinaire, non seulement l’avocat n’est pas l’ennemi mais il est l’allié. Et ensemble dans le champ public, nous sommes tenus solidairement par nos idéaux communs et notre serment, de proprement exercer cette défense de l’État de droit, des libertés et de la démocratie.
Manuela Cadelli
Juge
Autrice de La légitimité des élus et l’honneur des juges (Samsa 2022)
[1] Clémenceau, cité par https://academiesciencesmoralesetpolitiques.fr/2006/01/30/lavocat-roi-du-xixe-siecle/.
[2] Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, Gallimard, 1947, p. 65.
[3] J. Englebert et M. Cadelli, « Se taire c’est mentir », Obs. sous Cour eur.dr.h., Grde. Ch., Morice c. France, 23 avril 2015, R.T.D.H., 2017, p 169 et ss.
[4] Certains avocats l’affirment d’ailleurs sur leur site : https://www.avocats-legalex-namur.be/acteurs-justice/avocat-auxiliaire-justice.html : Les avocats sont des auxiliaires de la justice dont le rôle essentiel consiste à défendre les intérêts de leurs clients devant une juridiction.
[5] Dans l’arrêt Cour eur. dr. h., Kyprianou c. Chypre, 15 décembre 2005, la situation dans laquelle s’est retrouvée l’avocat était encore moins confortable dès lors que ce sont les juges qui se sont senti « profondément insultés » par les propos de l’avocat en cours d’audience, qui ont décidé de se saisir sur le champ du délit de contempt of court et de juger l’avocat en lui infligeant une peine de cinq jours d’emprisonnement. On comprend que dans de telles circonstances, la Cour européenne ait estimé que les juges « n’ont pas réussi à considérer la situation avec le détachement nécessaire » et que « les doutes de M. Kyprianou quant à l’impartialité de la cour d’assises de Limassol se justifiaient également sous l’angle de la démarche subjective » (§§ 131 et 132), pour dénoncer, in fine, « le manque d’équité de la procédure sommaire de contempt » (§ 181).
[6] Rappelons que la Cour européenne a énoncé dans son arrêt Gouveia Gomes Fernandes et Freitas E Costa c. Portugal, 29 mars 2011, que si les magistrats « ont bien sûr le droit de saisir les tribunaux afin de défendre leur réputation (voir, mutatis mutandis, Cordova c. Italie (n° 1), [30 janvier 2003]), ils doivent néanmoins faire preuve de la plus grande discrétion. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire » (§ 46).
[7] La Cour européenne le souligne très justement dans son arrêt Kyprianou c. Chypre, du 15 décembre 2005 : « A l’évidence, tout avocat, lorsqu’il défend un client en justice, […], peut se retrouver dans la situation délicate de devoir décider s’il doit ou non s’opposer à l’attitude du tribunal ou s’en plaindre, tout en gardant à l’esprit les intérêts de son client. » (§ 175).
[8] Il a également formulé dans le Rapport du groupe de travail relatif à la protection des magistrats (Rapport signé par R. Gelli, C. Champalaune et M. Thuau, remis au garde des Sceaux le 28 juin 2016 – www.justice.gouv.fr/publication/RapportProtectionMagistrats_28_06_2016.pdf), qui place de façon récurrente sur le même pied les agressions physiques (ou les menaces de telles agressions) dont sont victimes certains magistrats avec des « campagnes médiatiques virulentes » qui seraient orchestrées à leur encontre par des avocats (pp. 3, 5 et 7), sans toutefois ne citer d’exemple concret si ce n’est une interpellante référence aux arrêts Morice c. France et Bono c. France, du 15 mars 2016. Cette dernière affaire ne correspond en rien à une « campagne médiatique virulente » contre un magistrat puisqu’à l’origine de la condamnation disciplinaire de l’avocat Bono se trouvaient des accusations portées contre un juge d’instruction français de complicité de torture de son client par les services secrets syriens, accusations formulées dans des conclusions écrites prises pour la défense de son client et « ne sont pas sortie de la ‘salle d’audience’ » (§§ 52 et 54). Elle a conduit à un constat à l’unanimité de violation par la France de l’article 10 de la Convention, conformément à sa jurisprudence (voy. Cour eur. dr. h., Nikula c. Finlande, 21 mars 2002).
[9] R. Lecadre, « La juge, l’avocat et la liberté d’expression médiatique », Libération, 17 mars 2016.
[10] §167 de l’arrêt
[11] D’où le titre de notre note : « Se taire, c’est mentir ».
[12] A. Delvoye, « Introduction – La parole de l’avocat, de la liberté d’expression au devoir d’indignation », La parole de l’avocat, Th. Lagneaux (dir.), Anthémis, 2010, p. 11.
[13] P. Lambert, Les règles et Usages de la Profession d’Avocat du Barreau de Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 477.
[14] P. Lambert, op. cit., p. 478.
[15] Il ne s’agit évidemment plus, dans cette hypothèse, de plaider une cause particulière mais de dénoncer des dysfonctionnements ce qui n’interdit évidemment pas à l’autorité mise en cause de démontrer, pour autant que ce soit le cas, l’absence de dysfonctionnement. La critique formulée par P. Martens à l’égard de l’expression de l’avocat en dehors du prétoire, qui violerait les règles fondamentales du contradictoire et empêcherait – vu le lieu où l’expression est formalisée – à l’adversaire de donner son point de vue (« Conclusions – La parole de l’avocat », La parole de l’avocat, op. cit., p. 141), est sans relevance dans l’hypothèse qui nous occupe.
[16] Sous réserve naturellement des abus qu’il commettrait – l’argument est usé – mais ce n’est pas notre hypothèse.
[17] Simone Weil, L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain (1943), in Œuvres, Gallimard, « Quarto », 1999, pp. 1179 et 1180.
[18] Pour un bilan – positif – de la militance des juges entre 2013 et 2019 en Belgique, voy. M. Cadelli, « La militance des juges : d’une performance, l’autre » in A qui profite le Droit ?…, op. cit., pp. 131 à 158.
[19] P.Henry , « Devoir de réponse », La Tribune, n°123, 9 novembre 2017
[20] http://jeanpierre-buyle.avocats.be/sites/default/files/Tribune%20114%20-%2011%20mai%202017.pdf
[supsystic-social-sharing id="1"]